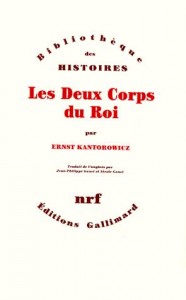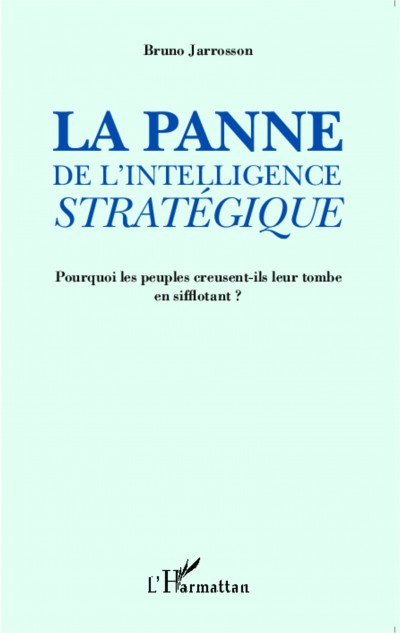Les catastrophes possibles et irréelles
« Mettre une gifle à une voyante et lui dire : » Et celle-là, tu l’as vu venir ? » »
Gracchus Cassar
Le flirt avec le fantôme
La stratégie n’est qu’un flirt avec le fantôme de l’avenir. Il s’agit toujours de structurer l’avenir.
Mais comme l’a fait remarquer saint Augustin, l’avenir n’est pas, il y a seulement un présent de l’avenir, une pensée de l’avenir dans le présent. L’avenir n’est pas connu, il est seulement imaginé. Aucune stratégie ne s’exempte de cette limite. Elle flirte avec un fantôme qu’elle prétend réel.
Nous ne savons pas ce que sera l’avenir. Mais dans la décision stratégique nous faisons comme si nous le savions.
Le fantôme n’est bel et bien qu’un fantôme. Idéal ou inquiétant, en tout cas bien différent du réel. L’avenir sera différent de ce que nous avons espéré ou craint. Peut-être en deçà de nos espérances, peut-être moins perfide que nos craintes. L’angoisse s’excite dans l’imaginaire, le réel est sa thérapie.
Nous ne savons pas ce que sera l’avenir mais dans la décision stratégique, nous agissons comme si nous le savions. L’imposture n’est pas loin. Nous n’agissons pas avec du savoir mais avec des croyances.
Est-ce la même chose de savoir et de croire ? Telle est la question que nous pose le flirt avec le fantôme.
Croire et savoir
La philosophie définit la connaissance comme une croyance vraie et justifiée. Savoir, c’est croire qu’une chose est justifiée. Si je sais que les saisons sont dues à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l’écliptique, c’est que j’ai de bonnes raisons de le croire. Je crois donc nécessairement que les saisons sont dues à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l’écliptique. Cette vision de la connaissance remonte, semble-t-il, à Platon qui dans ses dialogues tente de justifier ses croyances. Plus particulièrement, le Théétète et le Ménon établissent cette idée que le philosophe peut cheminer vers le savoir vrai s’il se soucie de la justification, de la charge de la preuve.
Dès lors, l’objet même de la philosophie est d’établir cette identité entre savoir et croire. Le philosophe est celui qui ne croit qu’en ce qu’il sait. C’est en cela qu’il est sorti de la caverne. Si nous regardons ce point à l’aune de la panne de l’intelligence stratégique, nous pouvons poser la question suivante : les opinions publiques croient-elles éviter la catastrophe climatique ?
Nous nous trouvons là devant un rapport étrange entre croyance et savoir. Un savoir est une croyance vraie justifiée, avons-nous dit. Mais dans la question posée ci-dessus, une évidence saute aux yeux : les croyances n’apparaissent pas du tout justifiées, du moins après coup.
Les opinions publiques savent que le réchauffement climatique va continuer et que les conséquences fâcheuses vont augmenter. Or elles agissent comme si ce n’était pas le cas.
Dans cet exemple, les acteurs agissent avec des croyances fondées sur des savoirs non justifiés. La situation est même pire, les acteurs agissent avec des croyances dont l’inverse est justifié. Dans ce cas, croire c’est admettre l’inverse de ce que l’on sait. Non seulement le lien entre savoir et croyance est coupé, il est même inversé.
Il y aurait de la panne de l’intelligence stratégique dans l’air que cela ne m’étonnerait qu’à moitié.
Nous agissons avec des croyances
Contrairement au savoir, la croyance engage l’action. Le savoir peut rester spéculatif, libre de toute attache, pur des atteintes de la réalité. Par contre, l’action engage une certaine forme de croyance sur le réel.
Je prends ma voiture parce que je crois qu’elle ne va pas tomber en panne, j’organise ce voyage parce que je crois que je serai encore en vie l’année prochaine. En fait je n’en sais rien, mais j’agis comme si je le croyais. Parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement. Agir c’est croire sans forcément savoir.
Dans ce cas, il faut distinguer l’action banale, quotidienne, présente et l’action stratégique qui porte sur le lointain. Si je me prépare à dîner, je n’ai pas besoin de croire à des choses incertaines. Il me suffit de savoir la recette, de l’appliquer. Et tout se passe bien. Peu d’incertitude, pas d’échéance au-delà du quotidien.
Par contre, l’action stratégique, qui engage un avenir plus lointain de façon incertaine contient un acte de foi au-delà du savoir. Nous agissons comme si nous croyons que l’action va réussir alors que nous ne le savons pas. La croyance semble se distinguer du savoir en ce qu’elle la dépasse.
Résumons : pour le philosophe qui examine son savoir, il y a nécessaire identité entre le savoir et la croyance. Savoir, c’est rendre ses croyances vraies et justifiées. Pour l’homme d’action, agir, c’est croire, y compris au-delà de ce qu’il sait. L’action présuppose la croyance mais pas le savoir. En ce sens, quand il y a action, l’identité entre croyance et savoir est rompue.
Il manque en fait dans ce raisonnement une exploration plus détaillée entre l’action et la croyance.
Le lien entre action et croyance : la rationalisation
Le lien entre action et croyance a été exploré par des spécialistes de la psychologie sociale, en particulier Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois[1]. Ces deux auteurs ont conçu de multiples expériences sur le lien entre croyance et action. Ces expériences conduisent toutes aux mêmes résultats.
Que nous dit la tradition rationaliste qui a d’ailleurs été utilisée au paragraphe précédent ? Que la croyance est le fondement logique et rationnel de la décision. C’est parce que je crois que ma stratégie va réussir que je la déploie dans l’action. Chaque fois que nous argumentons pour changer la croyance de quelqu’un, nous espérons en fait que par utilisation de ce postulat de rationalité, la personne va changer son action. La communication se fonde sur ce postulat.
Ce schéma qui va de la croyance à la décision est logique. Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois montrent aussi qu’il est souvent faux. Les expériences mettent en évidence un schéma inverse, celui de la rationalisation. L’action est la cause des croyances et non l’inverse.
Un fumeur va-t-il arrêter de fumer parce qu’on lui explique que c’est mauvais pour la santé de fumer ? Si le postulat de rationalité fonctionne, cette stratégie va réussir à tous les coups. Or elle ne réussit presque jamais. Par contre, il arrive fréquemment qu’un fumeur explique que ce n’est pas si mauvais que cela de fumer. Dans ce cas, le postulat de rationalisation fonctionne, le fumeur déduit sa croyance de son acte.
Le fait de fumer tout en sachant que cela est mauvais pour la santé produit dans l’esprit ce que l’on appelle une dissonance cognitive, une incohérence entre ce que l’on fait et ce que l’on croit. Il y a deux façons de faire disparaître cette dissonance cognitive, soit en changeant ce que l’on fait – postulat de rationalité – soit en changeant ce que l’on croit – postulat de rationalisation. Or si je suis attaché à mon action comme le fumeur à sa cigarette, il est plus facile, moins coûteux, de changer ce que je crois que ce que je fais. Il est plus facile de minimiser en paroles les risques de la cigarette sur la santé que d’arrêter de fumer. Une autre forme de rationalisation consiste à répéter que je vais arrêter bientôt.
Cet exemple du fumeur qui répète qu’il va bientôt arrêter de fumer sans jamais le faire nous montre la faiblesse du postulat de rationalité. Expliquer à un fumeur que c’est mauvais pour la santé de fumer dans le but de le faire arrêter de fumer, c’est présupposer que le fumeur fume pour améliorer sa santé. Ce qui n’a aucune chance d’être vrai. Le fumeur fume parce qu’il a terriblement envie de fumer, telle est la cause de son acte. S’attaquer à la croyance ne change rien à la cause réelle pour laquelle il fume.
Le schéma qui postule qu’une croyance est la cause d’un acte est faux et simpliste. Il y a généralement plusieurs causes à un acte et la croyance n’est qu’une cause parmi d’autres. Le postulat de rationalité ne peut donc pas être vérifié dans sa généralité. Par contre, la croyance et l’action ont partie liée en ce sens qu’il faut éviter la dissonance cognitive. Il faut raconter que l’on croit à la pertinence de ses actes et le racontant, on finit par y croire.
Le schéma apparaît alors être le suivant :
- Des causes circonstancielles conduisent à un acte,
- Cet acte doit être cohérent par rapport aux croyances affichées,
- Les croyances évoluent pour se conformer à l’acte.
La cause de la croyance n’est plus l’observation ou la réflexion mais bel et bien l’action. La croyance est désormais prête à se dissocier du savoir. Car parallèlement à ce schéma, l’acteur continue à savoir certaines choses. Même s’il explique que ce n’est pas si grave, le fumeur sait quelque part – comme on dit – que ce n’est pas bon pour sa santé de fumer.
Dans une situation douteuse, on peut donc agir comme si l’on croyait quelque chose tout en sachant que notre croyance est fragile ou fausse. Cet éclairage nous permet de reprendre les questions posées plus haut sur les croyances des acteurs.
Les opinions publiques croient-elles éviter la catastrophe climatique ?
Il n’y a plus d’arguments sérieux pour nier le réchauffement climatique dû à l’activité humaine. Il n’y a pas non plus d’argument sérieux pour réfuter les projections inquiétantes : élévation de la température de 2 à 5 °C dans la seconde moitié du xxie siècle. Cela nous le savons, mais pouvons-nous nous permettre de le croire ? Quand on commence à lister ce que cela devrait changer dans notre façon de vivre, on est vite tenté de refermer la boîte à croyances et de penser à autre chose.
On sait beaucoup et on croit peu.
Risque et solution, le principe de David Fleming
L’essayiste écologiste David Fleming (1940 – 2010) affirme que la propension d’une communauté à reconnaître l’existence d’un risque serait déterminée par l’idée qu’elle se fait de l’existence d’une solution. Cette affirmation serait une conséquence du principe de rationalisation que nous avons évoqué plus haut. Si je n’entrevois pas de solution à un problème, je ne peux pas agir pour mettre en œuvre une solution. Si je ne peux pas agir, je ne structure pas de croyance, je vais donc avoir tendance à ne pas croire au problème tout en sachant que le problème existe.
On trouve dans Les Pensées de Pascal la phrase suivante, à la fois triste et réjouissante : « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser. » De nombreuses œuvres littéraires ont montré que l’idée de la mort peut rendre la vie pénible. C’est donc une idée qu’il vaut peut-être mieux savoir écarter pour vivre sereinement. Nous savons que nous mourrons mais y croyons-nous vraiment ? Jean-Paul Sartre, dans L’Être et le Néant[2] explique pourquoi l’être ne peut pas penser le néant de son être quand penser est la seule façon d’être.
« Ainsi, nous devons conclure, contre Heidegger, que loin que la mort soit ma possibilité propre, elle est un fait contingent qui, en tant que tel, m’échappe par principe et ressortit originellement à ma facticité. Je ne saurais ni découvrir ma mort, ni l’attendre ni prendre une attitude envers elle, car elle est ce qui se révèle comme l’indécouvrable, ce qui désarme toutes les attentes, ce qui se glisse dans toutes les attitudes et particulièrement dans celles qu’on pendrait vis-à-vis d’elle, pour les transformer en conduites extériorisées et figées dont le sens est pour toujours confié à d’autres qu’à nous-mêmes. La mort est un pur fait, comme la naissance ; elle vient à nous du dehors et elle nous transforme du dehors. »
Jean Paul Sartre, L’Être et le Néant, p. 630-631
Sartre montre que sur ce sujet qui conditionne l’être, savoir et croyance sont dans une incompatibilité logique. Pascal quant à lui indique qu’il s’agit de « se rendre heureux ». L’idée de bonheur est à l’origine du phénomène de rationalisation. Nous vivons plus heureux si nous pouvons penser que nos décisions passées ont été pertinentes. Nous avons besoin de penser que ce que nous avons fait a du sens. À l’inverse, penser que ce que nous avons fait n’avait pas de sens et que nous nous sommes trompés est une idée douloureuse. Le regard que nous jetons sur notre passé et sur nos décisions n’est donc pas neutre. Il engage le bonheur présent.
Le savoir engage la connaissance, la croyance engage le bonheur.
Ce rapport nécessaire au bonheur permet de comprendre le principe de David Fleming qui a inventé l’antibiotique de l’âme. Qu’y a-t-il de plus déprimant que d’envisager un risque sans solution ? Ceci est aussi impensable que la mort pour Sartre. Moins j’aperçois de solution, moins je peux me permettre, au nom de la quête du bonheur, de croire au risque. Tandis que Hitler réarmait l’Allemagne, éructait ses menaces et occupait la Rhénanie, les Français dansaient sur l’air sympathique et joyeux de Tout va très bien madame la Marquise. Les paroles de cette chanson sont en soi un hymne au principe de David Fleming.
Stratégie de l’autruche finalement assez courante, je ferme mon esprit à des pensées désagréables. Les problèmes disparaissent de mon horizon à défaut de disparaître de la réalité. Comme le fumeur qui croit qu’il ne se ruine pas la santé puisqu’il ne pense jamais qu’il se ruine la santé.
Mais hélas, l’absence de certitude n’est pas certitude de l’absence.
Les deux corps
Dans son livre Les Deux Corps du Roi[3], l’historien Ernst Kantorowicz explique que le roi – au Moyen Âge – a deux corps : un corps d’homme comme tout un chacun et un corps symbolique qui représente la nation et ne meurt jamais. Kantorowicz note que cette idée est issue de la théologie chrétienne puisque pour un chrétien, l’Église est le corps du Christ sur Terre.
Il s’agit bien de deux corps différents et même déconnectés. Un exemple permettra de comprendre de quoi il s’agit dans l’esprit des hommes du Moyen Âge. Le 5 août 1392, le roi Charles VI est pris d’un premier accès de folie dans la forêt du Mans. Il attaque sa propre troupe et tue six personnes avant d’être maîtrisé. Il faut se rendre à l’évidence, le roi de France est fou. Ce qui entraînera la France dans des désastres militaires inouïs. Mais seul le corps terrestre est malade. Le corps symbolique quant à lui ne saurait subir les atteintes de la maladie. Charles va rester roi de France jusqu’à sa mort en 1422. Pendant trente ans, le royaume aura un roi fou et cela se traduira par une longue suite de désastres pour la France. Mais pendant cette période, personne n’a pensé à déposer le roi, à organiser une succession. Le corps symbolique, bien distinct du corps physique, était inviolable.
La responsabilité particulière qu’exerçait le roi produisait cette séparation des deux corps. Dans l’esprit de l’époque, la responsabilité du roi était de droit divin. Le sacre à Reims manifestait que le monarque recevait son pouvoir de Dieu en personne ou plutôt en trois personnes et qu’à ce titre, il ne pouvait pas l’aliéner. La première action politique de Jeanne d’Arc fut d’amener le fils de Charles VI – Charles VII un autre roi au corps débile – se faire sacrer à Reims. C’est l’engagement dans la responsabilité qui dissocie les deux corps. Jeanne d’Arc brûlait de sauver la France et elle a bel et bien réussi à brûler.
Nous sommes tous susceptibles d’avoir deux corps car nous sommes tous susceptibles d’exercer des responsabilités. Notre corps responsable, notre corps engagé dans l’action est autre que notre corps habituel car il est regardé. Il est l’outil de l’action et de la responsabilité. Nous l’habillons en fonction de cette action et de cette responsabilité.
Chaque homme engagé dans l’action, comme le roi, a deux corps : son corps physique et son corps responsable. Le corps physique est nourri, soigné, entretenu, réjoui. Le corps responsable est instrumentalisé.
Le corps physique sait des choses, le corps responsable croit des choses car on agit avec des croyances. Il arrive que ce que le corps physique sait, le corps responsable ne veuille pas le croire et il arrive aussi que ce que le corps responsable croit, le corps physique ne veuille pas le savoir. Cette hypothèse des deux corps n’a de sens que si nous postulons que le dialogue entre les deux corps n’est pas parfait. De même que le dialogue entre deux personnes passe par des malentendus nécessaires, des silences distraits et des incompréhensions inconscientes, le dialogue entre nos deux corps vise davantage la séparation que le rapprochement. L’objectif de chacun est de ne pas trop dialoguer avec l’autre pour n’être pas entravé dans sa logique.
Une forme d’irréalisme
Le plus grand péché en stratégie est certes le manque de réalisme. « Il n’y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités », comme l’a rappelé de Gaulle lors d’une allocution télévisée :
« Il est tout à fait naturel que l’on ressente la nostalgie de ce qui était l’empire, comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n’y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités ! ».
Allocution télévisée du 14 juin 1960
Certes mais il n’est pas simple de savoir ce qu’est la réalité. Notre savoir sur la réalité est un savoir construit. À ce titre, nous ne savons pas ce qu’est la réalité, nous construisons une image de cette réalité. Dans mes cours de philosophie des sciences, j’emmène mes élèves devant un miroir de grande taille pour qu’ils constatent que le miroir inverse la gauche et la droite. Une fois qu’ils savent cela, qu’ils l’ont constaté de visu, je leur fais faire une deuxième expérience devant le miroir qui leur montre que le miroir n’inverse pas la gauche et la droite. Il suffit pour cela de faire allonger un élève devant le miroir. Ceux qui sont restés debout constatent qu’en face de la tête, il n’y a pas l’image des pieds. Puis je leur démontre au tableau noir qui d’ailleurs est vert qu’il est scientifiquement impossible que le miroir inverse la gauche et la droite. Ceci pour montrer que l’idée courante que le miroir inverse la gauche et la droite est certes fausse, mais c’est cependant une construction de l’esprit fondée sur une propriété objective du miroir.
Nous ne savons pas exactement ce qu’est le réel, mais nous savons quelque chose du réel. Ce premier constat sur la connaissance est une première forme d’irréalisme par déformation. Ce que nous savons du réel est autre chose que le réel, c’est une vision déformée ou même enrichie de nos croyances. Comme le disait Kierkegaard : « On change des faits avec des idées, pas des idées avec des faits. » Enfin pas toujours.
Savoir n’est pas un processus réaliste mais idéaliste. Le savoir procède de l’idée. Voilà pourquoi il faut rappeler la nécessité du réalisme dans la stratégie, la confrontation des idées avec le réel.
Mais cela n’est rien encore. Car ce savoir déformé et idéaliste n’est pas la croyance qui fonde l’action. Même plié à notre représentation, le savoir n’est pas encore assez déformé pour justifier des actions et des stratégies si elles doivent être irréalistes. Même ce savoir-là, nous sommes susceptibles de ne pas y croire.
Dès lors, il ne faut pas s’étonner que tant de stratégies présentées comme raisonnables et réalistes soient en fait déraisonnables et infondées. Ceci ressortit à une idée profonde en nous : la différence entre savoir et croire.
Le piège abscons
Nous vivons mieux – avons-nous dit – si nous pouvons penser que nos actions passées ont du sens et ont été pertinentes. Danton sur la charrette qui l’emmène à l’échafaud dit à ses compagnons – entre deux plaisanteries : « Nous n’aurons pas vécu inutilement, notre œuvre subsistera. » Confronté au non–sens – Danton n’était pas croyant – il cherche un sens dans son passé.
Ce besoin de trouver un sens, et un sens plutôt positif, à nos décisions passées, crée un engagement dans l’action. Nous nous sentons solidaires de nos décisions passées, nous nous sentons le besoin de les justifier dans le présent. L’action crée un effet d’engagement.
Quand les décisions passées ont des conséquences négatives, cet engagement passé tourne au piège, un piège appelé en psychologie « piège abscons ». Le piège abscons, qui n’est pas qu’un piège à con puisqu’il peut s’emparer de tout un chacun, est obscur parce qu’il est difficile d’en percer le mécanisme une fois qu’on est dedans. Le sujet peut même renforcer le piège. Plus l’action a des conséquences négatives, plus cela peut donner de raisons de poursuivre. Quand les conséquences sont négatives, c’est que la stratégie n’a plus de justification externe. Son auteur sera donc conduit à renforcer les justifications internes. Moins les arguments sont convaincants, plus ils devront être affirmés avec vigueur. Plus il y a de doute, moins on peut se permettre de débattre.
Telle est la nature du piège abscons.
Nous l’avons détaillé parce qu’il est clair que le piège abscons est à l’origine de nombreuses pannes de l’intelligence stratégique.
Premier devoir de l’intelligence stratégique, donc, détecter et éviter les pièges abscons.
Thérapie factuelle
Nous avons à de nombreuses reprises souligné l’importance du réalisme comme antidote au manque d’intelligence stratégique. Confronter ses stratégies et ses croyances au réel n’est sûrement pas un procédé malheureux. Cela paraît tellement simple qu’on se demande pourquoi cette confrontation au réel n’évite pas plus souvent les soucis. Il existe trois raisons qui limitent l’efficacité de l’appel au réel. Revue de détail pour en améliorer l’usage :
- L’engagement émotionnel
- La difficulté dans la lecture des faits
- La réfutabilité.
L’engagement émotionnel
Nous l’avons évoqué à propos du piège abscons, nous sommes engagés émotionnellement dans nos décisions. Dès lors, les faits qui montrent que notre décision n’est pas pertinente nous procurent des émotions négatives. Il peut donc être bienvenu d’éviter les émotions négatives en ignorant les faits désagréables. C’est après tout la meilleure façon de garder intacte sa motivation. Cet engagement émotionnel est la cause du piège abscons sur lequel nous ne revenons pas.
La difficulté dans la lecture des faits
Le 15 août 1914, le lieutenant Charles de Gaulle est blessé à Dinant en Belgique lors du premier combat auquel il participe. Jusqu’à ce jour, ce Saint-cyrien de stricte observance supportait la doctrine stratégique qu’il avait apprise sur les bancs de l’école : l’offensive à outrance. Il avait même eu en 1912 une altercation avec son colonel à ce sujet, un certain colonel Pétain, obscur officier en fin de carrière qu’on s’apprêtait à mettre à la retraite.
Mais ce 15 août 1914, la leçon des faits lui semble lumineuse. D’un coup il comprend que ce qu’il a appris ne tient pas la route. Il change immédiatement d’avis sur la stratégie.
Cet événement pose une question : pourquoi ce qui est apparu au lieutenant de Gaulle dans une cruelle évidence n’a pas été vu par ses chefs ?
Les faits sont objectifs et nos idées sont subjectives. Voilà pourquoi nous pensons qu’il appartient aux faits de juger de la valeur des idées. Il ne s’agit que de mettre un peu d’objectivité là où on en trouve peu. Ce schéma de pensée qui reprend celui du philosophe Karl Popper est assez satisfaisant pour l’esprit. Tellement satisfaisant en fait qu’on se demande pourquoi il ne permet pas d’éviter la persistance dans la panne de l’intelligence stratégique.
Le schéma idéal où les faits viennent confirmer ou infirmer objectivement les théories laisse penser qu’il ne devrait pas y avoir de polémiques. Ni sur la stratégie, ni sur la politique, ni sur l’économie et encore moins sur la science. Or l’observation nous montre l’inverse. L’histoire n’est faite que de polémiques.
Ce schéma épistémologique idéal oublie simplement que les faits, pour dire le vrai et le faux des idées, doivent être extérieurs aux idées. Or on constate que les idées conditionnent en partie la lecture des faits.
La lecture des faits présente la difficulté suivante : ces faits ne sont pas isolés des théories. Ils ne sont pas donnés de façon objective mais lus et interprétés subjectivement. Dans ce cas, ils échouent à mettre de l’objectivité dans le monde. Les polémiques et les pannes de l’intelligence stratégique perdurent.
Mais cette difficulté de la lecture objective des faits n’est pas toujours insurmontable. Il nous appartient de tenter de séparer dans les faits ce qui est objectivement établi de ce qui est subjectivement ajouté en fonction de nos désirs et préjugés.
Cet effort de bonne foi dans la lecture des faits est sûrement une qualité pour éviter la panne de l’intelligence stratégique. Il s’oppose à la mauvaise foi dont Sartre faisait un principe de base du fonctionnement de l’esprit humain en lieu et place de l’inconscient.
La réfutabilité
Ainsi que nous l’avons dit, seuls les faits introduisent de l’objectivité dans les stratégies. Mais les faits qui confirment les stratégies ne prouvent par pour autant que la stratégie est bonne de façon générique. Une offensive réussie ne prouve pas que la stratégie de l’offensive soit toujours la meilleure, elle prouve seulement qu’elle a réussi dans les circonstances du moment. Par contre, il suffit d’un seul fait contradictoire pour prouver qu’une stratégie générique ne fonctionne pas de façon générique. Nous avons davantage de certitude sur le faux que sur le vrai, sur ce qui rate que sur ce qui réussit. On n’est jamais sûr qu’une stratégie va réussir mais on peut être sûr qu’elle va rater.
Il ne faut donc pas seulement chercher les confirmations d’une stratégie mais aussi les réfutations. Lorsqu’on met en place une stratégie, il est bienvenu de se poser dès le départ la question suivante : quels sont les événements qui prouveraient que ma stratégie échoue ? Ceci posé avant permet d’éviter les rationalisations a posteriori qui nous précipitent dans le bourbeux marais du piège abscons où croupissent les vestiges des stratégies subtiles et irréalistes.
Thérapie idéologique
De 1965 à 1968, Robert McNamara, secrétaire d’État à la Défense des États-Unis, a conduit la guerre du Vietnam comme il le raconte dans son livre Avec le recul, la tragédie du Vietnam et ses leçons[4]. Comme la guerre ne cesse de mal tourner, comme les généraux n’atteignent jamais les objectifs annoncés, les réunions à Washington sont assez polémiques. Surtout que George Ball, un des conseiller de McNamara, ne cesse de répéter, depuis le début de la guerre, que les États-Unis ne peuvent que la perdre.
Mais les polémiques, au lieu d’éclairer le sujet et de conduire à des décisions raisonnables, ne font qu’obscurcir la situation. La discussion se termine toujours de la façon suivante : « Si le Sud-Vietnam tombe entre les mains des communistes, alors tous les pays du Sud-est asiatique tomberont comme des dominos. » La théorie des dominos s’est emparée des esprits, assez puissante pour emporter la décision, contre l’évidence des faits.
Il est assez frappant de constater que McNamara qui écrit son livre trente ans après n’a toujours pas compris comment lui, le manager avisé et le stratège affûté, a conduit sont pays dans le plus spectaculaire désastre stratégique du xxe siècle, même si le titre à été remis en jeu au xxie siècle.
Le débat explicite portait sur l’opportunité de la guerre du Vietnam. Le débat idéologique sous-jacent qui guidait les conclusions portait sur la théorie des dominos. Mais ce débat restait sous-jacent, ce qui empêchait de le conduire et de le confronter aux faits.
La question que McNamara aurait dû se poser – qu’il ne s’est jamais posée, même avec le recul de trente années – est la suivante : la théorie des dominos est-elle vraie ?
En 1965, il est déjà patent que cette séduisante théorie qui s’empare si facilement des esprits est fausse. Car si la théorie des dominos était vraie, l’Autriche serait communiste, la Grèce serait communiste et Cuba ne le serait pas. Confrontée à la réalité, cette idéologie formée à partir d’une métaphore puissante ne tient pas. Mais les dirigeants américains polémiquaient sur la guerre du Vietnam, jamais sur la théorie des dominos.
Les choix stratégiques peuvent donner lieu à des controverses. Parfois ces controverses opposent des personnes, parfois elles se déroulent dans nos esprits. L’existence même des controverses est une insulte à l’idée que les faits sont les juges de paix ultimes et définitifs des idées. Les faits sont objectifs et s’imposent à tout le monde. Si les faits permettaient de juger de la valeur des idées, il n’y aurait jamais de polémiques entre idées. Il suffirait d’invoquer les faits pour éteindre les polémiques.
Or ce n’est pas le cas pour la raison indiquée plus haut. Les faits sont interprétés dans le cadre des idées, ils ne sont pas vierges de toute idée.
La thérapie idéologique consisterait à expliciter les idées qui sous-tendent la lecture des faits et à soumettre ces idées à un filtre des faits sans rapport avec la situation. Sous la polémique entre deux stratégies, on trouve en général une polémique entre deux idéologies. La thérapie idéologique consiste donc dans un premier temps à expliciter ces idéologies. Cela n’est pas fait pour la raison que l’idéologie conditionne la lecture des faits. Elle est donc inconsciente tout comme McNamara reste inconscient que la théorie des dominos surdétermine la façon dont il aborde la guerre du Vietnam.
Une fois explicitées, les idéologies peuvent être confrontées aux faits et pour certaines abandonnées.
Celui qui patauge dans la panne de l’intelligence stratégique que ne sait plus penser hors l’armature de son idéologie. Pour lui, l’idéologie n’a pas d’extérieur.
Au passage, nous avons glissé une idée choquante : l’idéologie conditionne la lecture des faits. Cette idée est choquante en effet car elle pose tranquillement un idéalisme massif face au réalisme. Après tout, les faits sont les faits, ils ne devraient pas dépendre de l’idéologie de celui qui les constate.
Thomas Kuhn et la polémique idéologique
L’épistémologue Thomas Kuhn, après avoir analysé en détail certaines polémiques scientifiques, affirme que la science se structure autour de ce qu’il appelle des « paradigmes ». Le paradigme a les caractéristiques suivantes :
- Il est irréfutable par décision méthodologique,
- Il conditionne la lecture des faits.
Avec ces deux affirmations, Thomas Kuhn s’éloigne clairement du réalisme cher à la philosophie des sciences et penche vers l’idéalisme. Si le paradigme est irréfutable par les faits et si même il conditionne la lecture des faits, il n’y a plus d’objectivité possible de la connaissance. C’est en cela d’ailleurs que la philosophie des sciences de Thomas Kuhn est choquante. La science pour Thomas Kuhn est seulement ce à quoi croient les scientifiques à un moment donné. Rien de plus. La science est mise sous le boisseau de la plus plate et la plus relativiste des sociologies. Que l’enfant Louis XVII ait été fait prisonnier était fâcheux mais peut-être politiquement utile, qu’il ait été confié à la garde d’un ignoble ivrogne était vile et sûrement inutile.
Si l’on critique hâtivement Thomas Kuhn, on oublie un aspect essentiel de sa philosophie. Thomas Kuhn a été frappé par le fait que la philosophie des sciences ne correspondait pas du tout à l’histoire des sciences. Les philosophes nous racontent une belle histoire mais cette histoire n’est pas celle de la science telle qu’elle se fait. Il s’agit de la science telle qu’ils se la racontent. En voulant une philosophie des sciences qui prenne en compte l’histoire des sciences, Thomas Kuhn fait preuve de plus de réalisme que les réalistes.
La leçon de Thomas Kuhn apparaît alors sous un jour qui nous concerne : c’est en explicitant les paradigmes que l’on dégagera les enjeux de la connaissance et finalement d’une connaissance plus ou moins solide.
Telle est bien l’objet de ce que l’on a appelé ici la thérapie idéologique : c’est en explicitant les idéologies qui sous-tendent les stratégies que l’on soumettra le plus efficacement l’idéologie au tribunal des faits. Pour éviter de s’enfoncer dans la panne de l’intelligence stratégique comme dans un piège abscons.
Réconcilier les deux corps du stratège
Avril 1961, Kennedy est président depuis trois mois quand il décide ou plutôt laisse faire l’attaque dite de la baie des Cochons sur Cuba. Ses conseillers lui affirment que ce sera un succès car le peuple cubain se soulèvera à l’arrivée de ses libérateurs. L’opération est un désastre qui ridiculise et fragilise ce tout jeune président. Kennedy convoque ses conseillers et leur dit en substance : « Cette opération a été un désastre et vous me l’avez tous conseillée. Je suis donc entièrement responsable, je n’avais qu’à pas vous écouter. »
Cela est d’un décideur.
Suite. Octobre 1962 : crise de Cuba. Les chefs militaires affirment péremptoirement à Kennedy que la stratégie la plus rationnelle est le bombardement puis l’invasion de Cuba. Mais Kennedy ne sent pas cette rationalité dans son corps de président. Cela le révulse car il discerne que cet engrenage peut conduire à la guerre nucléaire. Il se souvient de la baie des Cochons, de ce qu’il peut en coûter d’écouter des conseillers rationnels et sûrs d’eux. Son corps de président devrait peut-être les écouter puisque les conseillers du président sont censés être « les meilleurs et les plus intelligents » comme on a dit à l’époque. Mais son corps d’ancien combattant de la guerre du Pacifique se révulse. Il n’y croit pas.
Kennedy décide de réconcilier ses deux corps. Il décide que la recherche de solution doit minimiser le risque de guerre nucléaire.
Et au passage il sauve l’humanité.
Cela est d’un stratège.
Nous avons évoqué le livre Les Deux Corps du Roi de l’historien Ernst Kantorowicz. Le corps physique, entretenu et nourri, sait des choses d’un savoir immédiat. Le corps responsable, engagé dans l’action, doit fonder son action sur des croyances incertaines. Voilà pourquoi croire n’est pas savoir.
L’art de la stratégie bien sûr consiste à mettre de la pensée dans son action et de l’action dans sa pensée. Mais la pensée est libre et sans danger immédiat, l’action est contrainte et toujours risquée. La réconciliation de la pensée et de l’action n’a donc rien d’évident. Ces deux-là ne cessent de se chamailler.
Sous la dispute fréquente de la pensée et de l’action, le stratège peut par la méditation trouver quelque chose de plus rare et de plus essentiel qui ne se révèle qu’à ceux qui prennent le temps de méditer profondément : ses deux corps deviennent des amis pour autant qu’ils fassent connaissance et dialoguent. Ses deux corps se serrent la main dès lors qu’ils se reconnaissent et se découvrent amis. Cela donne un stratège prêt à l’emploi, serein et quillé.
[1] Robert-Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois : Petit Traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, PUG, 1987, La soumission librement consentie, PUG, 1998.
[2] Jean-Paul Sartre : L’être et le néant, Éditions Gallimard, 1943.
[3] Ernst Kantorowicz : Les Deux Corps du Roi, Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Gallimard, 1989.
[4] Robert McNamara : Avec le recul, la tragédie du Vietnam et ses leçons, Seuil, 1995.